Pour le modèle bismarckien, conçu en Allemagne à la fin du XIXème, la logique de contribution fonde le régime. À la manière d’une assurance, les droits acquis garantissent aux demandeurs d’emploi un revenu de remplacement pendant une période donnée.
Pour le modèle beveridgien, conçu en Angleterre à la fin de la seconde guerre mondiale, trois grands principes dominent : unité, universalité, uniformité. C’est l’appartenance à la communauté nationale qui fonde le droit à une indemnisation du chômage, sans aucun rapport avec les emplois exercés.
Les 7 différences entre le modèle de Bismarck et le modèle de Beveridge : le modèle bismarckien fonctionne en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas. Le système beveridgien fonctionne en Suède, en Finlande, en grande Bretagne, en Irlande :
- Modèle bismarckien : c’est une logique d’assurance professionnelle, les objectifs sont de maintenir un niveau de vie et d’assurer un revenu de remplacement, les principes sont basés sur une solidarité interprofessionnelle, pour lutter contre la pauvreté, les bénéficiaires sont les salariés et leurs familles, les prestations sont proportionnelles au salaire, le financement est basé sur les cotisations assises sur les revenus professionnels, la gestion est confiée aux partenaires sociaux.
- Modèle beveridgien : c’est une logique d’assurance universelle, les objectifs sont de lutter contre la pauvreté et de couvrir les besoins primaires. Les principes sont basés sur une solidarité nationale, les bénéficiaires sont toute la population, les prestations sont forfaitaires et identiques pour tous, le financement est basé sur les cotisations sociales et l’impôt, la gestion est confiée à l’État.
En France, avant la prochaine réforme annoncée, le régime demeure essentiellement bismarckien, puisqu’il accorde un revenu de remplacement aux salariés privés d’emploi et il est administré par les partenaires sociaux. L’évolution de son financement a introduit un principe d’inspiration beveridgienne. Les cotisations salariales ont été remplacées par le prélèvement d’une fraction de la CSG. Le régime d’assurance chômage n’est plus uniquement financé par les salariés et les employeurs mais aussi par l’impôt. L’État s’est immiscé dans la gouvernance.
L’assurance chômage présente en Europe une grande diversité. Chaque système d’indemnisation du chômage est le fruit d’une histoire sociale propre et s’applique dans des contextes différents. Il existe des différences notables en matière de financement, de durée de cotisation, de niveau ou de durée d’indemnisation.
Certains pays se caractérisent par des systèmes d’indemnisation à deux niveaux et juxtaposent ainsi prestations d’assurance et prestations d’assistance chômage. Si certaines caractéristiques des systèmes d’assurance chômage peuvent apparaître en première lecture plus ou moins restrictives ou protectrices, il convient de les appréhender dans le cadre de l’économie d’un système d’indemnisation du chômage et de ses différents niveaux de protection. De même, l’hétérogénéité des situations individuelles peut induire de grandes différences entre droits théoriques et droits réels.
En France, les dépenses pour les prestations liées au risque emploi représentent 1,8 % du PIB en 2022 ; elles sont largement supérieures à la moyenne européenne. Elles se situent au deuxième rang en Europe. C’est un montant quasi équivalent aux dépenses militaires, et inférieur à la dépense intérieure de recherche et développement (2,18 % du PIB) mais nettement supérieur au budget de la justice (0,21 % du PIB).
| Situation au 1er mai 2024 | Taux de cotisations | Condition d’affiliation minimale | Durée d’indemnisation | Montant d’indemnisation |
|---|---|---|---|---|
| France | Cotisations employeurs à l’assurance chômage 4,05 % Salariés : CSG Plafond du salaire de référence : 15 456 euros |
6 mois au cours des 24 derniers mois ou au cours des 36 derniers mois pour les salariés de 53 ans et plus | Durée d’indemnisation minimale est de 6 mois. La durée maximale est de 18 mois pour les moins de 53 ans, de 22,5 mois pour les 53 et 54 ans, de 27 mois pour les 55 ans et plus | 57 % du salaire journalier de référence (SJR) ou 40,4 % + partie fixe, dans la limite de 75 % du SJR Montant minimum : aucun minimum Montant maximum : 8 811 euros |
| Allemagne | Cotisations à l’assurance chômage 2,6 % dont : employeur 1,3 %, salarié 1,3 % Plafond du salaire de référence : 7 750 euros pour les anciens länder, 7 450 euros pour les nouveaux länder |
12 mois au cours des 30 derniers mois | Entre 6 et 24 mois | 60 % ou 67 % du salaire de référence net selon la situation familiale Aucun montant minimum Montant maximum : 3 299 euros anciens länder, 3 264 euros nouveaux länder |
| Pays-Bas | Cotisation à l’assurance chômage employeur : 2,64 % pour les CDI, 7,64 % pour les CDD Plafond du salaire de référence : 5 480 euros |
26 semaines au cours des 36 dernières semaines (10 heures par semaine minimum). | Entre 3 et 24 mois selon la durée d’affiliation antérieure | 75 % du salaire de référence pendant les deux premiers mois, puis 70 % Aucun minimum Maximum : 75 % du salaire de référence |
| Danemark | Cotisation globale salarié : 8 % Cotisation forfaitaire en cas d’adhésion à une caisse d’assurance chômage |
Avoir perçu un revenu minimal de 33 063 euros au cours des 3 dernières années | 3 848 heures (2 ans maximum) sur une période de 3 ans | 90 % du salaire de référence sans plafond mais allocation plafonnée à 3 146 € Aucun minimum |
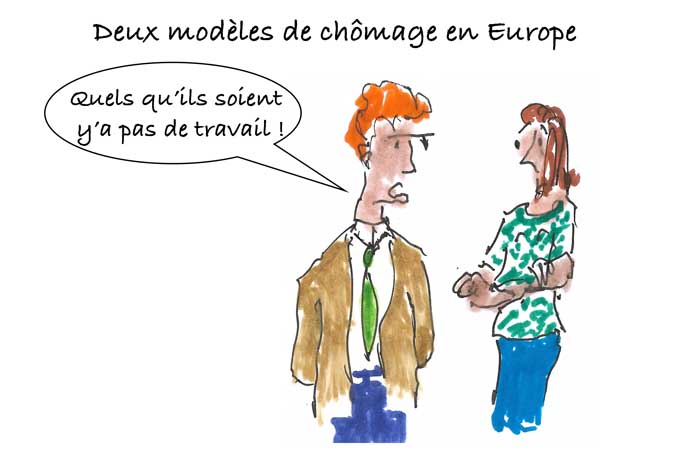
Références

